L’histoire de la crise financière et économique actuelle est d’abord une histoire américaine. Après un moment de choc, le coupable a vite été trouvé : la Réserve fédérale, la banque centrale des Etats Unis, et sa politique de faible taux d’intérêt sont présentées comme les responsables de cette crise qui secoue la planète depuis août 2007. Une fois encore, il est ainsi suggéré que l’économie réelle serait saine et que c’est l’Etat, fût-ce par l’intermédiaire d’une banque centrale indépendante, qui serait le seul coupable. Tout au plus, certaines asymétries d’information, certaines incitations perverses, notamment en matière immobilière, auraient échappé à la vigilance des régulateurs. Une telle représentation du monde n’est que le dernier avatar d’une idée que l’on croyait remisée depuis longtemps : celle de la dichotomie entre la sphère réelle de l’économie et sa sphère monétaire et financière.
Taux moyen d’imposition du 0,01 % les plus riches aux Etats-Unis, 1960-2004,en %
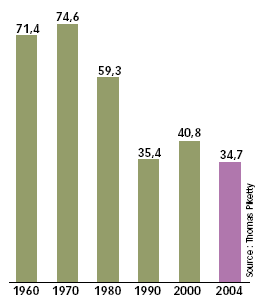
Pourtant à y regarder de plus près, il n’est pas difficile de comprendre les causes réelles de la débâcle financière : elle n’est que la contrepartie d’exigences initiales excessives de rentabilité financière, devenues sans rapport avec le rythme de croissance de l’économie réelle. En fait, c’est au coeur de ce qui a été appelé à la fin des années 1990 la "nouvelle économie" - au sens d’une économie prétendument engagée dans une croissance définitivement forte et sans à-coups - qu’il faut rechercher les causes de la crise.
Cette économie reposait tout simplement sur un malentendu. Des institutions et des règles financières présumées optimales étaient censées fournir aux différents acteurs les incitations propres à accélérer la croissance sans qu’il n’y ait plus de difficultés de coordination entraînant des crises et des fluctuations. Dans ce contexte, des taux de rentabilité du capital, qui auraient été jadis considérés comme extraordinaires, ont été considérés comme normaux.
Comment, alors, ne pas rapporter la crise financière aux changements drastiques intervenus dans la répartition des revenus et des richesses, singulièrement aux Etats-Unis qui en sont l’épicentre ? Les mécanismes sont en effet simples à décrire. L’exigence d’une rentabilité du capital sans rapport avec le taux de croissance effectif ne peut qu’entraîner une forte redistribution des revenus au détriment des ménages les plus modestes. Cette redistribution a des effets négatifs sur la demande qui, de ce fait, ne peut être maintenue que grâce à un endettement accru de ces mêmes ménages. Un tel processus ne pouvait se poursuivre indéfiniment : la croissance ainsi obtenue ne pouvait que déboucher sur une crise financière de grande ampleur, compte tenu de la nature des mécanismes mis en oeuvre pour atteindre les objectifs attendus de rentabilité financière.
L’éclatement de la bulle de la high-tech au début des années 2000 avait déjà révélé que les institutions en place, et notamment les institutions financières, n’étaient pas susceptibles de soutenir la formation de croyances cohérentes. Cette incohérence avait débouché sur des excès d’investissement qui ont retenti sur les valeurs boursières. Loin de produire une accélération définitive de la croissance, la financiarisation sophistiquée de l’économie a créé les conditions d’une plus forte instabilité. L’éclatement de la bulle des valeurs technologiques avait conduit par la suite les autorités à pratiquer une politique monétaire accommodante. Dans un premier temps, cette politique a évité la récession, voire la dépression, mais elle a également accentué les dérives de la finance.
L’enthousiasme désormais modéré pour les valeurs technologiques a cédé la place, chez les investisseurs, à la recherche de gains obtenus grâce à des produits fondés sur l’endettement des ménages. La bulle immobilière a succédé à la bulle des valeurs technologiques. La rationalité des prêts ainsi octroyés reposait sur la croyance que les prix des actifs immobiliers augmenteraient sans cesse, de telle sorte qu’il importait peu au prêteur de savoir si l’emprunteur pourrait ou non faire face à ses remboursements. L’amorce de la baisse des prix du logement ne pouvait que provoquer un éclatement de cette bulle immobilière et des défaillances en série des ménages endettés et de leurs créanciers. La crise financière devenait d’autant plus inévitable que les risques étaient cachés par les nouveaux mécanismes financiers.
Vision de court terme et creusement des inégalités
Quelles que puissent être les attentes en matière de taux de croissance suscitées par les innovations financières, elles ne sauraient correspondre aux taux de rentabilité exigés par les investisseurs. Cela ne pouvait avoir que deux conséquences : des choix industriels sacrifiant le long terme au court terme et un creusement des inégalités de revenus. Les entreprises, au lieu de procéder à des investissements à long terme, ont en effet engagé des opérations de restructuration visant à accroître leur rentabilité immédiate, ainsi que des opérations spécifiquement financières (rachats d’actions, hausse des dividendes) afin d’augmenter leurs cours boursiers. Les évaluations comptables des actifs à la valeur de marché ne pouvaient que les encourager à procéder ainsi. Il s’en est suivi des formes de désindustrialisation, des destructions d’emplois parfois qualifiés et l’augmentation des emplois précaires. L’interdépendance accrue propre aux relations de sous-traitance ou de cotraitance, devenues des relations de marché à court terme, a fragilisé fortement le système industriel.
Loin d’être la conséquence de contraintes de financement caractéristiques de systèmes financiers insuffisamment développés, cette évolution est au contraire le produit de ces systèmes sophistiqués de dilution des risques. Les produits financiers les plus complexes comme les plus simples présentent de vrais avantages, tout à fait indéniables : ils permettent à une économie de fonctionner en rendant compatibles des attitudes à l’égard du temps forcément différentes, entre ceux qui recherchent des engagements longs et ceux qui veulent préserver la liquidité de leurs engagements, en proposant la couverture de risques de prix ou de change inévitables. Mais ces mêmes produits, peu transparents, ne permettent jamais d’échapper aux risques dits parfois résiduels, en fait des risques systémiques si l’on considère les conséquences potentiellement élevées de ces risques résiduels.
Naturellement, on ne peut que dénoncer certaines pratiques financières : la concurrence entre prêteurs, qui les a amenés à consentir des crédits plus risqués à des taux d’intérêt moindres, des banques qui n’ont pas gardé une part significative de leurs créances quand les prêts devenaient plus risqués. Mais l’essentiel est ailleurs. La finance n’est pas coupable d’un simple point de vue technique. Elle ne le devient que si elle est le fourrier d’une redistribution drastique des revenus préjudiciables à la croissance.
La face cachée d’une rentabilité fortement accrue des actifs financiers, c’est en effet un accroissement des écarts de revenus personnels. Ceux-ci ont été souvent faussement attribués à des biais introduits par le progrès technique dans les qualifications demandées et au fonctionnement d’un marché du travail rendu flexible. La "grande compression", selon l’expression de l’économiste américain Paul Krugman, des écarts de revenus des années 1950 et 1960 aux Etats-Unis a été remise en cause. Paul Krugman en donne une illustration saisissante en comparant les rémunérations de la firme de référence en 1969, General Motors (GM), avec celles de la firme de référence en 2005, Wal-Mart. La rémunération du PDG de GM était, en 1969, égale à 88 fois celle de ses salariés moyens, alors que celle du PDG de Wal-Mart en 2005 était, elle, 1 278 fois supérieure. Mais plus encore, en dollars constants 2005 : le revenu des salariés moyens a reculé de 40 000 dollars pour les ouvriers de GM en 1969 à 18 000 dollars pour les employés de Wal-Mart en 2005 [1]. Globalement, la part du décile supérieur dans la distribution des revenus est passée de 27 % en 1966 à 45 % en 2001 [2].
Accroître l’endettement pour réguler la demande
Le soutien prodigué aux ménages impliquant d’encourager les prêts susceptibles de leur être consentis ne faisait que traduire le souci plus ou moins explicite, mais justifié, de préserver une croissance mise en danger par les inégalités de revenus. La stagnation, sinon la baisse relative, des salaires devait être compensée par la possibilité pour les ménages de s’endetter à des taux très bas et d’accéder ainsi à des marchandises importées à bas prix. Les nouveaux mécanismes financiers ont fait croire qu’il était possible de diluer les risques impliqués par les prêts aux ménages les moins solvables. En fait, l’endettement en question a fait office de régulation de la demande pour faire pièce au creusement des inégalités et, quoi qu’on en dise, assurer la croissance, non pas une croissance artificielle, mais une croissance effective.
Le problème est que cet arbitrage, en quelque sorte imposé à l’Etat, ne pouvait qu’induire des distorsions rendant la croissance difficilement soutenable. La faute principale des gouvernements est de ne pas avoir mis en place les régulations prudentielles nécessaires ; ils ont, au contraire, accepté le démantèlement de celles qui existaient et qui avaient été conçues à la suite de la Grande Dépression de 1929. Ils y ont été poussés par une idéologie qui a cru asseoir sa légitimité sur les avantages et les certitudes que les techniques d’une finance de plus en plus sophistiquée étaient censées procurer. Les importations en provenance des pays émergents ont permis de contenir les prix et, par suite, d’écarter des signaux susceptibles de conduire les autorités monétaires à relever les taux d’intérêt. Cette situation ne pouvait être qu’instable.
Part du 0,01 % des ménages les plus riches dans le total des revenus aux Etats Unis, en %
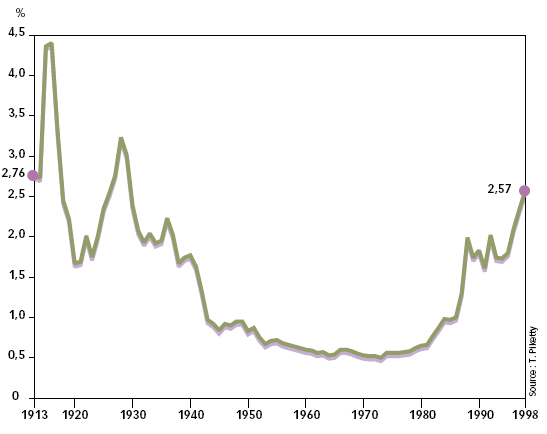
L’histoire des pays de la zone euro est, certes, différente. La politique monétaire y a été moins accommodante et les inégalités de revenus ne se sont pas creusées de manière aussi drastique grâce, en partie, à un système social dont les mécanismes ont été grosso modo maintenus en dépit de tentatives plus ou moins poussées de les démanteler. La contrepartie a été une croissance faible et un chômage élevé dans les grands pays de la zone. Cette contre-performance a souvent été attribuée à la lenteur des réformes tendant à rendre le marché du travail plus flexible. Pourtant, si l’on considère l’expérience allemande des années 2000, le rebond de croissance n’a procédé que de la croissance des exportations dans une économie où les réformes du marché du travail ont avant tout rendu la répartition des revenus plus inégalitaire et affaibli la demande intérieure. Le chemin emprunté a ainsi quelque ressemblance avec celui suivi par les Etats-Unis, s’agissant des conséquences en matière de répartition.
Un problème structurel
En fait, le problème auquel les différentes économies sont confrontées est d’abord un problème de demande. Mais il ne s’agit pas d’un problème simplement conjoncturel appelant des mesures temporaires de relance ou des hausses immédiates de salaires que les entreprises ne pourraient pas supporter. Il s’agit bel et bien d’un problème structurel : ce qui est en jeu, c’est la façon dont la répartition des revenus structure la demande et, par suite, l’offre.
Le défi à relever est particulièrement redoutable dans la mesure où un changement de norme de répartition prend du temps pour voir le jour et exercer ses effets. La forte diminution des inégalités de revenus, qui a contribué à expliquer la croissance forte et régulière des décennies 1950 et 1960, était amorcée dès l’avant-guerre. L’enjeu est donc de concevoir et de mettre en oeuvre des mesures à effets immédiats et à moyen terme, au premier rang desquelles des mesures allégeant la fiscalité des ménages les moins riches, augmentant les allocations chômage et diminuant le fardeau des ménages les plus endettés.
Il est grand temps de revenir aux fondamentaux de l’économie et de ne plus croire que l’intelligence des financiers résoudra tous les problèmes. Il est grand temps de reconsidérer les véritables sources de la croissance, qui résident dans une certaine égalisation des revenus et des richesses, source d’une demande abondante et diversifiée, garante de l’efficacité des investissements.
Extrait du magazine Alternatives Economiques (hors série), n° 80 (04/2009).
[1] L’Amérique que nous voulons, par Paul Krugman, éd. Flammarion, 2008.
[2] "Controversies about the Rise of American Inequality : a Survey", par Robert J. Gordon et Ian Dew-Becker, NBER Working Paper n° 13982, mai 2008
Observatoires des Inégalités - 02.07.09




















Sem comentários:
Enviar um comentário