« Comment soigner votre angélisme en dix leçons ? Sur ce créneau, c’est Sébastian Roché qui propose le guide le plus efficace […] Le criminologue avance en effet qu’il est nécessaire de rompre avec ce qu’il appelle "la tolérance d’indifférence" (je tolère d’autant mieux que je ne suis pas touché), ainsi qu’avec un "économisme" synonyme de fatalisme. "L’action sur les causes profondes n’est pas forcément possible à court terme. Est-ce une raison pour ne rien faire ?", lance-t-il en direction de "la gauche et ses sociologues" » (Le Monde des livres, 3 mai 2002).
« Inutile de préciser que l’angélique "politique de la ville" n’a jamais su faire reculer l’insécurité dans les banlieues, dont les habitants en sont les premières victimes […]. Ce renoncement […] est porté par le Syndicat de la magistrature, qui préfère critiquer les méthodes policières plutôt que les actes des délinquants, et par de nombreux sociologues qui, comme Laurent Mucchielli, soutiennent que la violence des banlieues est d’abord une révolte contre "une société injuste et raciste" » (Le Figaro, 13 novembre 2001).
Les sociologues Sébastian Roché et Laurent Mucchielli ont incarné deux types de position dans le débat sur la délinquance juvénile, comme l’exprime le premier lorsqu’il dit, sur un ton amusé, qu’il est « l’anti-Mucchielli » (entretien avec l’auteure, 17 octobre 2008). Le premier a contribué à en légitimer les contours en conceptualisant les notions « d’insécurité » et « d’incivilités », le second a cherché à remettre en question les termes et le contenu du débat. Mais, le fait d’appartenir à la « minorité visible » des chercheurs [3] et de devoir ce statut au moins partiellement au « problème de l’insécurité » (qu’ils le cautionnent ou le dénoncent), pourrait les faire apparaître comme des équivalents structuraux [4].
Sébastian Roché (qui se présente à la fois comme sociologue et comme politiste) et Laurent Mucchielli interviennent dans un débat public marqué par la présence d’« experts » qui ont pour trait commun de tenir un discours alarmiste sur la délinquance juvénile des quartiers populaires : Lucienne Bui-Trong, commissaire général aux Renseignements généraux, Xavier Raufer [5], Alain Bauer, directeur d’une entreprise de sécurité, Didier Peyrat, magistrat, Richard Bousquet, commissaire... [6]. Proches de la police (les Renseignements généraux, la Police nationale ou encore l’Institut des hautes études sur la sécurité intérieure – aujourd’hui baptisé INHES), ces experts sont à l’origine de plusieurs ouvrages qui les ont consacrés comme spécialistes de la question. Auteur avec Xavier Raufer de Violences et insécurités urbaines, (« Que sais-je ? », 1998, 15 000 exemplaires vendus en deux ans), Alain Bauer, qui s’appuie sur les travaux de Sébastian Roché, incarne un certain type de position dominante dans l’espace des discours sur « l’insécurité ». Né en 1962, dans un milieu de petits commerçants, ce militant socialiste rocardien acquiert des responsabilités au sein de l’Unef-ID et de l’université Paris 1 où il obtient un DESS de politiques publiques et de gestion des organisations. Il est ensuite chargé de mission à Matignon, où il s’occupe de l’enseignement supérieur puis des problèmes de police [7]. En 1994, constatant l’intérêt soulevé par « la sécurité » chez les élus, il crée une société de conseil en sécurité qui travaille essentiellement avec les collectivités territoriales, les conseils généraux, les organismes parapublics et publics. En 1996-1997, il participe à la 7e session d’auditeurs de l’INHES, qui dépend du ministre de l’Intérieur, et occupe une position centrale dans l’espace des études sur la délinquance. Il intervient dans différentes formations universitaires (Sciences Po., la Sorbonne, l’École nationale de la magistrature, les écoles de gendarmerie et de police...). Outre qu’il s’appuie sur un discours d’autorité scientifique et sur son insertion (toute relative) dans le milieu académique officiel pour légitimer ses interventions dans la sphère médiatique et politique, Alain Bauer incarne, de par sa position, la contribution des médias à la construction d’une notoriété publique.
Chercheurs au CNRS, auteurs d’ouvrages publiés chez des éditeurs reconnus, Laurent Mucchielli et Sébastian Roché interviennent pour leur part dans diverses formations universitaires et professionnelles (le fait que le premier enseigne à la Protection judiciaire de la jeunesse et le second à l’École nationale de la police est un indicateur de leur positionnement). Ils confirment la corrélation entre une médiatisation importante et une forte notoriété scientifique [8].
C’est autant par motivation scientifique que pour répondre à une demande sociale qu’ils ont été amenés à travailler sur la délinquance, illustrant ainsi la faible autonomie de ce domaine d’étude [9]. S’appuyant sur le modèle des enquêtes statistiques d’opinion de Lazarsfeld, Sébastian Roché démontre en sociologue, dans sa thèse, le bien-fondé du « sentiment d’insécurité » : « C’était le début de l’interrogation sur le sentiment d’insécurité [...] À partir de 1981-1983, le Front national prend ses premières municipalités. Il y a un intérêt politique », dit-il (entretien avec l’auteure, 2008). Il constate alors le décalage entre le désintérêt du milieu académique pour ce sujet et l’engouement de bibliothécaires, d’enseignants et de journalistes. Après la publication du Sentiment d’insécurité, en 1993, aux PUF, son ouvrage intitulé La délinquance des jeunes. Les 13-19 ans racontent leurs délits (Paris, Éd. Le Seuil, 2001) l’amène à sortir du cercle académique pour s’adresser à un lectorat plus large : « J’ai discuté avec Hervé Hamon, co-directeur de la collection L’épreuve des faits. Je lui ai dit : “J’ai compris un certain nombre de choses sur la manière dont on peut expliquer les résultats de recherche, je me sens prêt pour faire une sorte d’essai, quelque chose de compréhensible par des gens qui ne sont pas spécialistes” » [10]. Ce livre contribue ainsi à faire exister dans le langage courant la notion d’« incivilité », importée des États-Unis, et qui désigne, en France, les petits actes qui, par leur aspect répétitif, rendent la vie des habitants des quartiers populaires difficile (tags, lancers de pierre, insultes, bruits, ampoules cassées...) [11].
C’est en revanche la volonté de produire un contre-discours sur l’insécurité qui amène Laurent Mucchielli à écrire Violences et insécurité, fantasmes et réalités dans les débats publics (Paris, La Découverte, 2001, 2002). Il présente cet ouvrage comme « une espèce d’analyse un peu alternative de tout ce débat sur la sécurité, qui essaye de décortiquer un petit peu et de comprendre justement pourquoi on a cette espèce de surenchère sans fin dans laquelle tout le monde s’est lancé. Et en même temps, c’est un petit peu le point sur ce qu’on peut savoir du réel » (entretien avec l’auteure, en 2006). Ce livre rencontre un succès inattendu : « Moi, c’était la première fois que je faisais un livre un peu grand public, on va dire. Jusque-là, j’avais fait des travaux de recherche, des articles dans des revues universitaires, j’avais publié ma thèse, 500 pages, je faisais des travaux de type vraiment académique essentiellement. Et puis, ce bouquin a marché du feu de dieu. À ce jour, cumulé sur 4, 5 ans, je dois être à 17, 18 000 exemplaires. Pour la sociologie, c’est important » (entretien avec l’auteure, 2006).
Des travailleurs sociaux, des éducateurs, des sociologues, des élus l’invitent à participer à des débats et des colloques. Il en devient en quelque sorte le porte-parole : « Il y avait toute une série d’acteurs sociaux qui attendaient, qui avaient besoin d’un discours de ce type, qu’ils ne trouvaient plus ailleurs », dit-il (entretien avec l’auteure, 2006). Très peu de temps après la publication de son livre, il décide, avec des collègues, de monter le groupe CLARIS (Agir pour clarifier le débat sur l’insécurité) dont la naissance officielle date de la parution d’une tribune éponyme dans le quotidien Libération. Un site Internet est créé, avec des commentaires d’actualité, des résumés de travaux de recherches, des comptes-rendus de livres, un agenda. Le succès de cet ouvrage, qui s’explique partiellement par le fait qu’il traite des médias, amènera Laurent Mucchielli a réitérer l’expérience avec un second livre, Le scandale des tournantes. Dérives médiatiques, contre-enquête sociologique (La Découverte, 2005).
Rôles et postures
La posture adoptée par chacun de ces chercheurs apparaît comme intimement liée au problème à débattre. En effet, une lutte interne à la lutte répartit les entrepreneurs « d’insécurité » et leurs opposants autour de la définition de la fonction de chercheur. À l’« expert » qui se propose de fournir des solutions à un problème défini de l’extérieur, s’opposerait le chercheur « engagé », qui mettrait sa connaissance au service d’une idée ou d’une vision du monde. Plusieurs auteurs ont montré que ces postures n’étaient pas exclusives les unes des autres, et qu’un chercheur pouvait passer de la posture d’expert à celle de sociologue critique et/ou engagé, tout en faisant de la sociologie académique.
Sébastian Roché, qui se présente comme un « expert », critique les sociologues se disant « de gauche », ce positionnement qu’il qualifie d’ « idéologique » conduisant, selon lui, à une forme d’« aveuglement » [12]. S’ils constatent les désordres dans les quartiers défavorisés de banlieues, ils n’en verraient pas la « portée destructrice » [13]. De même ne tiendraient-ils pas compte de la « dimension ethnique » de la délinquance. Sa posture est parfaitement ajustée à la demande d’expertise des médias télévisés [14] : « Ce n’est pas vous qui créez l’événement. C’est le contraire de la production scientifique. Vous êtes sollicités quand ça sert », témoigne Sébastian Roché (entretien avec l’auteure, 2008). Il fournit ainsi aux journalistes des instruments de décryptage du discours des hommes politiques sur un sujet dont il entend maîtriser la dimension technique. Cette position lui permet de donner des conseils et de remettre en question certaines annonces politiques. Par exemple, dans le cadre d’un colloque sur les politiques de sécurité, il préconise d’analyser au plus près du terrain « les causes du sentiment d’insécurité [...], mais aussi les diverses « incivilités » repérées dans une cité où les vitres cassées ne sont pas réparées [...] afin de mieux saisir les multiples réalités des peurs ressenties par les citoyens » [15]. Vis-à-vis des hommes politiques, cette posture supposée « neutre » lui permet d’être sollicité par des élus de droite comme de gauche, chacun pouvant « récupérer » ce qui l’intéresse dans son travail. Par exemple, dit Sébastian Roché, la lecture de La société incivile aurait fait changer d’avis le maire de Vénissieux sur la question de la sécurité [16]. À côté de l’utilisation des résultats de ses enquêtes, sa fonction d’expert lui permet également d’occuper des positions institutionnelles variées. Outre la commission du Sénat sur la délinquance des mineurs, il participe à commission Blandine Kriegel sur la violence et la télévision [17], est nommé au Conseil national de la sécurité routière par le gouvernement Jospin. Membre du Haut conseil à l’intégration, du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de la police, il est secrétaire général de la Société européenne de criminologie (ESC, université de Cambridge). À la télévision, il ajoute à la posture d’expert celle de porte-parole des « victimes » de « l’insécurité ». Au journal télévisé (France 2, 29 janvier 1996), dans le cadre d’un reportage sur le travail d’une postière dans une cité HLM, il déclare, que « les gens se trouvent devant une multiplication de petits incidents qui les rendent à moitié fous ». Autre exemple : dans une édition de l’émission Mots croisés consacrée à la violence des mineurs, en compagnie de Julien Dray et de Pierre Bédier, il analyse l’attitude des enfants qui dévalorisent la gravité de leurs actes pour pouvoir aller plus loin (11 novembre 2000).
Laurent Mucchielli dénonce quant à lui l’étiquette d’« expert » dont se parent les entrepreneurs du problème public ici étudié, en montrant que leur discours est en réalité idéologiquement orienté. Cette posture restreint de facto l’étendue des sollicitations politiques dont il fait l’objet à des petits partis (les Verts, le Parti communiste français) et peut expliquer que son accès à des positions dans le champ politico-administratif soit moins diversifié que pour Sébastian Roché. Mais, pour les journalistes, il incarne une forme de contestation « présentable », dans la mesure où il ne porte pas les stigmates du militant (agressif, revendicatif). Il qualifie d’ailleurs son engagement de « citoyen » (et non de politique). La comparaison du traitement journalistique du colloque organisé par Le Monde et la revue Esprit à la mairie de Paris (« Démocratie, éducation, sécurité : quelles valeurs ? Quelles pratiques ? », le 22 mai 2002) et de celui du « Forum contre les violences policières et sécuritaires », organisé quelques jours plus tard à la Bourse du travail de Saint-Denis [18] illustre cela. Ses interventions ont une dimension pédagogique qui répond bien à la demande de simplification des médias. Enfin, son ancrage en France (à la différence, par exemple, de Loïc Wacquant), le fait de diriger une collection à La Découverte, un éditeur reconnu, ses dispositions favorables à l’égard des journalistes, peuvent également permettre de comprendre pourquoi, parmi les différents acteurs engagés [19] dans la dénonciation de la « panique morale » [20], Laurent Mucchielli ait été choisi comme son représentant par certains journalistes : « Dès qu’ils veulent tirer le sociologue critique, ils ouvrent le tiroir et ils me sortent » dit ainsi Laurent Mucchielli (entretien avec l’auteure, 2006). À la télévision, il intervient à la fois comme expert et sociologue critique, par exemple lorsqu’il commente les mesures mises en place dans le cadre des politiques de lutte contre l’insécurité sur le plateau de Télé matin (France 2, 16 août 2001), ou encore lorsqu’il conteste le contenu et la méthode du questionnaire de l’enquête de victimisation initiée par le maire d’Orléans au journal télévisé régional de France 3 (15 octobre, 19/20, Orléans)… Il peut aussi revêtir les habits de porte-parole des jeunes des cités, comme l’illustre une édition du journal télévisé de 13 heures, où il déclare que « les premières causes de mort des policiers, c’est d’abord que les délinquants veulent leur échapper », pointant ici la répression policière dont ils sont l’objet (France 2, 9 novembre 2001).
La façon dont ces deux sociologues, compte tenu de leur positionnement, sont intervenus dans la presse écrite suggère que Le Figaro et Libération ont chacun incarné un pôle du débat public sur le « problème social de l’insécurité ». Laurent Mucchielli est sollicité plus souvent par Libération et L’Humanité, alors que Sébastian Roché l’est plus fréquemment par Le Figaro. On note pour lui 22 occurrences dans Le Figaro contre 6 dans Libération, contre respectivement 5 et 23 pour Laurent Mucchielli. À la télévision, on peut dégager également une ligne de clivage entre C dans l’air et Mots croisés, diffusées sur France 5 et France 2, et les émissions d’Arte [21].
Un lieu de constitution et de diffusion du « sens commun » : l’émission quotidienne C dans l’air (France 5, 17 h 40-19 h 00)
Cette émission constitue l’un des lieux d’observation privilégiés de la production et de la diffusion de la doxa sur « l’insécurité ». Entre le 3 octobre 2003 et le 31 décembre 2005, douze émissions ont été consacrées aux « violences urbaines ». Cette catégorie d’origine policière s’est très largement diffusée dans la presse, dans l’édition, dans le milieu politique, sans pour autant renvoyer à une réalité bien définie. Pour cette raison, il importe de regarder comment elle a été construite, présentée, objectivée, autrement dit, comment ceux qui participent à cette émission contribuent à la faire exister. La rubrique livres et articles de presse est particulièrement riche en enseignements. L’ouvrage d’Alain Bauer et de Xavier Raufer, Violences et insécurité urbaines, figure dans chacune des bibliographies qui accompagnent les émissions. On y trouve également les ouvrages de Sébastian Roché (La délinquance des jeunes, Paris, Le Seuil, 2001 ; Nos politiques de sécurité, Le Seuil, 2005), de Laurent Mucchielli (Violences et insécurité dont l’extension, Fantasmes et réalités dans le débat français, n’y figure pas), de Stéphane Beaud et Michel Pialoux (Violences urbaines, violences sociales, Paris, Librairie Arthème-Fayard, 2003). Ces travaux scientifiques sont cités parmi des livres rédigés par des policiers reconvertis dans des sociétés de conseil (Banlieue en flammes de Charles Pelligrini, ancien patron de l’Office centrale de répression du banditisme, PDG d’une société de conseil en sécurité depuis 1990, pilote d’avion privé, expert en sûreté aérienne, consultant pour Europe 1 sur les problèmes de criminalité et de terrorisme…). La composition des plateaux contribue à délimiter les contours du thème à débattre. On y trouve, parmi les invités réguliers, Alain Bauer (quatre émissions sur ce thème), Sébastian Roché (trois interventions), des policiers dont Bruno Beschizza, secrétaire général du syndicat Synergie officiers (3 émissions), des magistrats. Enfin, le directeur adjoint de L’Express – indice de la position de cette émission dans le champ journalistique – est venu s’exprimer dans trois émissions.
Devenir un « bon client »
Au fur et à mesure de leurs interventions dans la presse écrite et audiovisuelle, Sébastian Roché et Laurent Mucchielli conviennent qu’ils ont appris à devenir de « bons clients » en s’adaptant aux formats et aux modalités d’intervention dans les médias. Laurent Mucchielli s’exprime dans les espaces réservés aux intellectuels, tels que les pages Opinions, Débats et Horizons des quotidiens nationaux. Dans les médias audiovisuels, il dit avoir appris à s’exprimer de façon « claire, simple et directe » : « Leur question essentielle c’est : “est-ce que le type passe bien ?” Moi, ça m’est arrivé plein de fois que le journaliste m’appelle. Je dis : “Ben non, je peux pas mais je peux vous donner le nom de tel collègue”. “Est-ce qu’il passe bien ? Est-ce qu’il parle bien ?” » (entretien avec l’auteure, 2006). À la télévision, il veut « éclairer » le grand public, il explique la nécessité d’être pédagogue, capable de « vulgariser » ses travaux et de s’exprimer dans un temps réduit : « Si on me dit : “Dites l’essentiel en dix minutes, un quart d’heure”, je le fais. Le but du jeu, c’est d’être efficace. C’est de faire passer le message ».
Pour Sébastian Roché, la dimension médiatique a très tôt constitué un élément de son travail, à travers la production de résumés [22]. Diffuser les résultats de la recherche au plus grand nombre est l’un de ses objectifs : « C’est important de montrer que les sciences humaines produisent des résultats [...] Trente secondes sur TF1, c’est des milliers de gens qui vont vous oublier instantanément, mais même, 0,9% de 4 millions, c’est énorme. Tous les décideurs vont vous voir, eux. Ils vont regarder ce média-là » (entretien avec l’auteure, en 2008). Il dit s’être formé aux médias par la pratique, en commençant par des petits journaux (presse régionale, radio confessionnelle et/ou militante), puis en intervenant dans des journaux plus importants en termes d’audience et/ou de notoriété. Il s’est également constitué progressivement un carnet d’adresses en entretenant le contact avec des journalistes qui étaient, plusieurs années plus tôt comme lui, en début de carrière (entretiens avec l’auteure, 2008). Comme Laurent Mucchielli, il a appris à répondre à leur demande – « Les émissions sont scénarisées, on intervient à un moment donné et point final » – dans le format requis : « Il y a des formats en 30 secondes ou en 500 pages, je me suis dit que je n’étais pas moins capable de faire les deux » [23].
Cet apprentissage des rôles et des manières d’être, à la télévision en particulier (être clair, précis, parler en un minimum de temps, utiliser un ton modéré, sans excès), met en évidence un processus circulaire, les journalistes faisant appel aux interlocuteurs les plus conformes à leurs attentes, l’acquisition d’un capital médiatique conduisant ces interlocuteurs à s’exprimer selon les formats imposés. Amenés à intervenir dans un débat public dominé par un discours de type alarmiste sur la petite délinquance des jeunes des quartiers pauvres, Laurent Mucchielli et Sébastian Roché remplissent ainsi les conditions requises pour occuper des positions qui leur préexistent. En offrant des arguments immédiatement mobilisables, sans pour autant se démarquer du monde académique, ils participent à construire l’axe autour duquel s’organise le débat public, axe qui va du pôle compréhensif au pôle répressif, et sur lequel se distribuent de manière inégale les différents agents engagés dans le débat sur question de « l’insécurité ».
[1] Sur l’importation de cette thématique des États-Unis en Europe, cf. Loïc Wacquant, Les prisons de la misère, Paris, Liber, Raisons d’agir, 1998.
[2] Ce texte est une version remaniée d’un article à paraître dans la revue Questions de communication.
[3] Cette expression est utilisée par Caroline Lensing-Hebben dans son livre, Les Experts cathodiques. Chercheurs face à la tentation médiatique, Lormont, L’INA/Le bord de l’eau, 2008. L’auteure s’appuie sur une étude qui montre que ceux qui apparaissent plus de six fois par an représentent à peu près 3% des chercheurs du CNRS (« Culture scientifique et communication vers le grand public », Journal du CNRS, n°184, mai 2005).
[4] Cette opposition recouvre une distinction entre « réalistes » (qui souscriraient à une réponse policière et répressive) et « angéliques » (qui auraient une approche plus « compréhensive »), entre chercheurs « pragmatiques » et « chercheurs engagés » (cf. infra), entre partisans du paradigme de l’individualisme méthodologique (qui postule que la délinquance trouve son explication chez le délinquant) et défenseurs du déterminisme social (pour qui les causes sont à rechercher dans des mécanismes sociaux plus généraux). Cf. Éric Macé et Angelina Peralva, Médias et violences urbaines. Débats politiques et construction journalistique, Paris, La Documentation française, 2002
[5] « Rencontré par l’intermédiaire des Presses universitaires de France, il [Xavier Raufer, de son vrai nom de Bongain] a un parcours aux antipodes du mien » écrit Alain Bauer. « Militant d’Occident dans les années 1950 [...], il a quitté l’organisation dans les années 1960 puis a rejoint, comme journaliste, L’Express [...] Nous différons beaucoup sur les réponses ou les conséquences. Peu sur la réalité [...] Il n’est ni antisémite ni négationniste, mais il est de droite », in Alain Bauer, Grand O, Les vérités du grand Maître du Grand Orient de France, Paris, Denoël, 2001, pp. 41-42. « En tant que directeur des collections Criminalité Internationale (CI) et Défense & Défis Nouveaux (D&DN), Xavier Raufer a publié, de 1996 à 2002, 31 livres aux PUF » (cf. http://www.xavier-raufer.com/collec...).
[6] Sur ces experts, cf. Laurent Mucchielli, Violences et insécurité, fantasmes et réalités dans les débats publics, Paris, La Découverte, 2001, 2002 ; Pierre Rimbert, « Les managers de l’insécurité. Production et circulation d’un discours sécuritaire » in Laurent Bonelli, Gilles Sainati éds., La machine à punir, Paris, L’esprit frappeur, 2000, p. 161-202 ; Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de « l’insécurité », Paris, La Découverte, 2008.
[7] Alain Bauer, Grand O... op. cit., p. 35. Sur la biographie d’Alain Bauer, le lecteur se reportera également aux travaux cités à la page précédente. Entre autres fonctions, il sera nommé membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme (2000-2003) et de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde, 2005-2007), président du Conseil d’orientation de l’observatoire national de la délinquance, en 2003, président de la Commission sur le contrôle des fichiers de police... Son élection comme grand maître du Grand Orient, en 2000, lui permettra d’étendre son influence, en plus de son insertion dans différentes sphères du pouvoir.
[8] Luc Boltanski, Pascale Maldidier, « Carrière scientifique, morale scientifique et vulgarisation », Informations sur les sciences sociales, 9 (3), pp. 99-118, 1970, Caroline Lensing-Hebben, op. cit.
[9] Comme l’ont montré Gérard Mauger, Hyacinthe Ravet, Sylvie Tissot, in La délinquance des mineurs. Pour un bilan critique des discours savants. Rapport à la protection judiciaire de la jeunesse, Paris, ministère de la Justice, 2004.
[10] « Le chercheur et les médias. Entretien avec Sébastian Roché », pp. 167-177, in Douillet A.-C., Zuanon J.-P., éds, Quarante ans de recherche en sciences sociales. Regards sur le CERAT 1963-2003, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2004.
[11] Cf. le dossier consacré aux « incivilités » par la revue Problèmes politiques et sociaux (Paris, La Documentation française, n°836, 24 mars 2000).
[12] Sébastian Roché se réfère ici à l’ouvrage de François Dubet, D. Lapeyronnie, Les quartiers d’exil, Paris, Seuil, 1992.
[13] Sébastian Roché, Insécurité et libertés, Paris, Seuil, 1994.
[14] Cf. Caroline Lensing-Hebben, op. cit.
[15] Colloque organisé les 20 et 21 février 1997, Erich Incyian, « Les politiques de sécurité manquent d’études et d’indicateurs cohérents », Le Monde, 26 février 1997.
[16] « Le chercheur et les médias... » art. cit., p. 170.
[17] Rapport rendu le 14 novembre 2002 à Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture.
[18] Ce forum a été organisé par le Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB), le réseau « contre la fabrique de la haine », des collectifs locaux et des associations (dont le Groupe d’information et de soutien des immigrés-GISTI, Act-Up, Droits devant !! et les syndicats Sud et la la Confédération nationale des travailleurs-CNT).
[19] Plusieurs intellectuels et professionnels se sont mobilisés contre la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 et la promotion des centres fermés pour mineurs délinquants.
[20] À partir de l’analyse du traitement journalistique des « sous-cultures juvéniles » Mods et Rock de l’Angleterre des années 1960, Stanley Cohen à proposé le concept de « panique morale » pour désigner « un événement, une condition, une personne ou un groupe de personnes qui ont été récemment “définis comme une menace pour les valeurs et les intérêts d’une société” » (Folk devils and moral panics, London, Mac Gibbon and Kee, 1972, p. 9.). Les objets de ces paniques morales sont à la fois nouveaux et anciens, transparents (dans la mesure où tout le monde peut les voir) et opaques, d’où le recours aux experts pour en parler.
[21] Sources : INA – base du dépôt légal, recherche par « mots clés » effectuée sur la période 1995-octobre 2005.
[22] « Le chercheur et les médias... », art. cit., p. 169.
[23] « Le chercheur et les médias », art. cit., p. 172.
http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article305


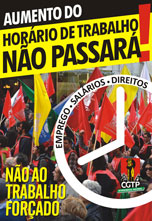
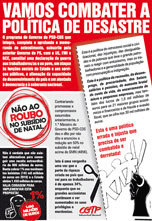
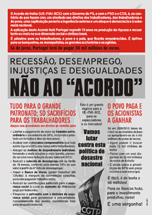















Sem comentários:
Enviar um comentário