Par son contenu, ce texte occupe une place à part. On retient généralement de Marx ses anathèmes contre le lumpenproletariat (prolétariat loqueteux, en haillons ou en guenilles), couche parasitaire sinon ennemie, versatile, complaisante à l’égard des classes possédantes, volontiers corruptible [2]. Quant à la sociologie du crime, anglo-américaine notamment, elle ne retient souvent qu’un résumé simpliste autour des liens entre pauvreté et criminalité, des intérêts de classe servis par le droit pénal et de la répression étatique. Ce texte atypique défie ces clichés. Sa clarté et son brio dispensent de tout commentaire superflu ; signalons simplement sa drôlerie, son ton un peu incertain, mi-ironique mi-sérieux, où s’exprime le talent proprement littéraire de Marx.
Du point de vue de l’héritage de Marx, le texte n’a guère dépassé le stade de l’intuition géniale, de la source d’inspiration évocatrice mais sans postérité intellectuelle consistante ou systématique. Les échos, fidèles ou non, qui lui ont été donnés, sont cependant nombreux. Il est ainsi difficile de ne pas y voir une anticipation du renversement attribué à un auteur bien peu marxien, Durkheim, qui a soutenu d’un autre point de vue le caractère socialement normal du crime et son appréciable fonction de manifestation et de consolidation de la conscience collective. Par ailleurs, on peut voir dans le concept foucaldien de « gestion différentielle des illégalismes », pris dans toute son ampleur, une manière de prolonger cette intuition et ses concepts annexes, en particulier celui d’armée industrielle de réserve (le thème de la plèbe manipulable par les classes dominantes). L’insistance actuelle de Loïc Wacquant sur le caractère éminemment productif de l’État pénal – dont l’avènement s’accompagne de la production de catégories de pensée, de vocables normatifs, de textes juridiques, d’agents spécialisés, d’outils statistiques, de dispositifs d’action publique, etc. – en constitue aussi une réactualisation.
Sur le plan culturel, un retentissement original du texte de Marx se donne à voir dans la série télévisuelle The Wire, dont les auteurs revendiquent une lecture classiste du monde social. Elle présente clairement le caractère productif du commerce des drogues illégales, qui non seulement fait vivre les policiers appointés pour le combattre, mais fait monter d’un cran leur sagacité et leurs savoir-faire en les poussant à mettre au point un ingénieux système d’écoute…
Bénéfices secondaires du crime [3]
Non seulement le crime est normal, mais il est facile de prouver qu’il a bien des utilités.
Un philosophe produit des idées, un poète des vers, un curé des sermons, un professeur des bouquins, etc. Un criminel produit la criminalité. Mais si les liens entre cette branche soi-disant criminelle de la production et toute l’activité productrice de la société sont examinés de plus près, nous sommes forcés d’abandonner un certain nombre de préjugés. Le criminel produit non seulement la criminalité mais aussi la loi criminelle ; il produit le professeur qui donne des cours au sujet de la loi criminelle et de la criminalité, et même l’inévitable livre de base dans lequel le professeur présente ses idées et qui est une marchandise sur le marché. Il en résulte un accroissement des biens matériels, sans compter le plaisir qu’en retire l’auteur dudit livre.
De plus, le criminel produit tout l’appareil policier ainsi que de l’administration de la justice, détectives, juges, jurys, etc., et toutes ces professions différentes, qui constituent autant de catégories dans la division sociale du travail, développent des habiletés diverses au sujet de l’esprit humain, créent de nouveaux besoins et de nouveaux moyens de les satisfaire. La torture elle-même a permis l’invention de techniques fort ingénieuses, employant une foule d’honnêtes travailleurs dans la production de ces instruments.
Le criminel produit une impression tantôt morale, tantôt tragique, et rend un « service » en piquant au vif les sentiments moraux et esthétiques du public. Il ne produit pas seulement les livres de droit criminel, la loi criminelle elle-même, et ainsi les législateurs, mais aussi l’art, la littérature, les romans et les drames tragiques dont le thème est la criminalité, tel que Oedipe et Richard III, ou Le Voleur de Schiller, etc.
Le criminel interrompt la monotonie et la sécurité de la vie bourgeoise. Il la protège ainsi contre la stagnation et fait émerger cette tension à fleur de peau, cette mobilité de l’esprit sans lesquelles le stimulus de la compétition elle-même serait fort mince. Il donne ainsi une nouvelle impulsion aux forces productrices. Le crime enlève du marché du travail une portion excédentaire de la population, diminue la compétition entre travailleurs, et jusqu’à une certaine limite met un frein à la diminution des salaires, et la guerre contre le crime, de son côté, absorbe une autre partie de cette même population. Le criminel apparaît ainsi comme une de ces « forces équilibrantes » naturelles qui établissent une juste balance et ouvrent la porte à plusieurs occupations soi-disant « utiles ».
L’influence du criminel sur le développement des forces productrices peut être détaillée. Est-ce que le métier de serrurier aurait atteint un tel degré de perfection s’il n’y avait pas eu de voleurs ? Est-ce que la fabrication des chèques bancaires aurait atteint un tel degré d’excellence s’il n’y avait pas eu d’escrocs ? Est-ce que le microscope aurait pénétré avec autant d’efficacité le monde commercial de tous les jours s’il n’y avait pas eu de faux-monnayeurs ? Le développement de la chimie appliquée n’est-il pas dû autant à la falsification des marchandises et aux tentatives pour y remédier, qu’aux efforts productifs honnêtes ? Le crime, par le développement sans fin de nouveaux moyens d’attaquer la propriété, a forcé l’invention de nouveaux moyens de défense, et ses effets productifs sont aussi grands que ceux des grèves par rapport à l’invention des machines industrielles.
Laissant le domaine du crime privé, y aurait-il un marché mondial, est-ce que les nations même existeraient s’il n’y avait pas eu de crimes nationaux ? L’arbre du mal n’est-il pas aussi l’arbre du savoir depuis le temps d’Adam ? Le jour où le Mal disparaîtra, la Société en serait gâtée, si même elle ne disparaît pas !
[1] Notons que sa traduction prend des libertés avec le texte original, et le clôt arbitrairement en coupant un passage conclusif sur Mandeville. On peut la comparer avec celle de Jean Malaquais et Maximilien Rubel sur xxx (elle-même recopiée avec une erreur…).
[2] Cette hostilité est, il est vrai, lisible dans les grandes œuvres politiques. Sur l’origine et les usages de cette notion, voir R. Huard, « Marx et Engels devant la marginalité : la découverte du lumpenprolétariat », Romantisme, 18 (59), 1988, p. 5-17, disponible sur Persee.fr.
[3] Texte reproduit grâce à l’aimable autorisation du traducteur André Normandeau et du site classique des sciences sociales. Référence originale version papier : Karl Marx, « Bénéfices secondaires du crime », Déviance et criminalité. Textes réunis par Denis Szabo avec la collaboration d’André Normandeau, pp. 84-85. Paris, Librairie Armand Colin, 1970, 378 pp. Collection U2. [Source : Theorien über den Mehrwert, vol. I, pp. 385-387, éd. par Karl Kautsky, 1905-1910. Traduit par André Normandeau]. Disponible en ligne en version intégrale.


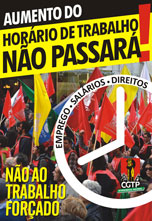
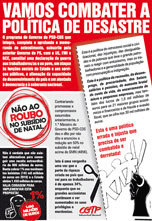
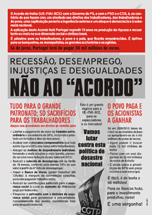















Sem comentários:
Enviar um comentário