Wu Ming 1 - Traduction Serge Quadruppani
Par ailleurs, la version originelle de ce texte, publiée sur le site des Wu Ming, est à lire ICI.
La semaine dernière [1], The Morning Call, un quotidien de Pennsylvanie, a publié une enquête longue et détaillée, intitulée « Inside Amazon’s Warehouse », sur les terribles conditions de travail dans les entrepôts Amazon de la Lehigh Valley. Le reportage, résultat de mois d’interviews et de vérifications, est en train de faire le tour du monde et il a été repris par le New York times et d’autres médias mainstream. Le tableau est sombre : extrême précarité du travail, climat de chantage permanent et absence de droits, rythmes inhumains, avec vitesse redoublée d’un jour à l’autre (de 250 à 500 colis par jour, sans préavis), par une température qui dépasse les 40° et en une occasion au moins, a atteint les 45°, mesures disciplinaires aux dépens de ceux qui ralentissent le rythme ou, simplement, s’évanouissent (un rapport du 2 juin dernier évoque le chiffre de 15 travailleurs évanouis sous l’effet de la chaleur), licenciements « exemplaires » instantanés, le réprouvé étant raccompagné à la porte sous les yeux de ses collègues. Et ce n’est pas tout. Lisez-la toute entière, l’enquête. Elle en vaut la peine. La phrase-clé est prononcée par un ex-magasinier : « They’re killing people mentally and physically. »
À en juger par les commentaires en ligne, beaucoup tombent des nues, découvrant seulement maintenant qu’Amazon est une méga-corporation, et Jeff Bezos un patron qui – comme il est courant chez les patrons – veut réaliser des profits au mépris de toute autre considération sur la dignité, l’équité et la sécurité. Comme on aurait dû le soupçonner, le « miracle » Amazon (super-réductions, expéditions très rapides, « longue traîne » [2], offre apparemment infinie) repose sur l’exploitation de la force de travail dans des conditions vexatoires, dangereuses, humiliantes. Exactement comme le « miracle » Walmart, le « miracle » Marchionne [3] et tout autre miracle entrepreneurial que les médias nous ont proposés pendant des années. Ce qu’on vient d’écrire devrait être évident, et ne l’est pourtant pas. La révélation ne concerne pas une entreprise quelconque, mais Amazon, sorte de « bon géant » dont – en Italie aussi – on a toujours parlé de manière acritique, sinon adoratrice et populiste. The Morning Call a rompu l’enchantement. Il y a quelques jours encore, à quelques exceptions près, les médias (et les consommateurs eux-mêmes) achetaient rubis sur l’ongle la propagande d’Amazon. Désormais, on cherchera peut-être plus souvent confirmation, on fera les vérifications nécessaires, on ira voir les bluffs éventuels. Avec l’aggravation de la crise, le nombre de sceptiques semble augmenter.
Le problème des multinationales perçues comme moins « entrepreneuriales », plus « cool » et éthiquement – presque spirituellement – meilleures que les autres concerne beaucoup de compagnies associées à Internet de manière si étroite qu’on les identifie avec le réseau lui même. Autre cas typique : Apple.
iPhone, iPad, youDie
L’année dernière, une vague de suicides parmi les ouvriers de Foxconn a fait scandale – avant d’être enterrée sous des tonnes de sable et de silence. Dans les usines de cette multinationale chinoise sont assemblés iPad, iPhone et iPod [4]. En réalité, les morts avaient commencé avant, en 2007, et ont continué par la suite (le dernier suicide certain remonte à mai dernier ; un autre ouvrier est mort en juillet dans des circonstances suspectes). Au total, une vingtaine d’employés se sont tués. Des enquêtes de diverses origines ont indiqué parmi les probables causes les rythmes de travail infernaux, le manque de relations humaines à l’intérieur de l’usine et les pressions psychologiques émanant du management. Quelquefois, c’est même allé bien plus loin que des pressions psychologiques : le 26 juillet 2009, un salarié de 25 ans dénommé Sun Danyong, s’est jeté dans le vide après avoir subi un passage à tabac par une équipe de nervis de l’entreprise. Sun était soupçonné d’avoir volé ou perdu un prototype d’iPhone. Quelles solutions a adopté Foxconn pour prévenir de telles tragédies ? Eh bien, l’usine a notamment installé des « filets anti-suicide » [5].

Ces coulisses du monde Apple n’attirent pas beaucoup l’attention, en comparaison des bulletins médicaux de Steve Jobs ou de pseudo-événements comme l’ouverture, dans la très centrale via Rizzoli de Bologne, du plus grand Apple Store italien. À cette occasion, des gens ont passé la nuit dans la rue afin de pouvoir entrer dans le temple. Ceux-là ne savent rien du mariage de travail et de mort en amont de la marque qu’ils vénèrent. Dans le capitalisme, mettre la plus grande distance possible entre l’ « amont » et « l’aval » est l’opération idéologique par excellence.
Fétichisme, assujettissement, libération
Quand on parle de la Toile, la « machine mythologique » de nos discours – alimentée par l’idéologie que, de gré ou de force, nous respirons chaque jour – re-propose un mythe, une narration toxique : la technologie comme force autonome, sujet doué de son propre esprit, réalité qui évolue d’elle-même, spontanément et théologiquement. Au point que certains – on ne le rappellera jamais assez – ont eu la belle idée de poser la candidature d’Internet (qui, comme tous les réseaux et les infrastructures sert à tout, donc aussi à faire la guerre) au… Prix Nobel de la Paix.
Ce sont les rapports de classe, de propriété, de production qui sont occultés : on n’en voit que le fétiche. Le Karl Marx des pages sur le fétichisme de la marchandise [6] s’avère alors précieux : « Ce qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux. »
Ce sont les rapports de classe, de propriété, de production qui sont occultés : on n’en voit que le fétiche. Le Karl Marx des pages sur le fétichisme de la marchandise [6] s’avère alors précieux : « Ce qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux. »
« Forme fantastique d’un rapport des choses entre elles ». Comme les ordinateurs interconnectés au niveau mondial. Derrière la fantasmagorie de la Toile, il y a un rapport social déterminé, et Marx entend : un rapport de production, un rapport d’exploitation. Sur de tels rapports, la rhétorique du Réseau jette un voile. On peut parler pendant des heures, des jours, des mois, de la Toile en n’effleurant qu’à l’occasion la question de qui en est propriétaire, de qui détient le contrôle réel des nœuds, des infrastructures, du hardware. On pense encore moins à la pyramide de travail – y compris para-esclavagiste – qui est incorporée dans les dispositifs que nous utilisons (ordinateur, Smartphone, Kindle) et des conséquences pour la Toile elle-même.
Il y a des multinationales qui, tous les jours (en ligne) exproprient des richesses sociales et (dans les coulisses) pressurent la main-d’œuvre aux quatre coins du monde, et pourtant, elles sont considérées comme… « moins multinationales » que les autres. Tant qu’on ne se rendra pas compte qu’Apple est comme Monsanto, que Google est à l’image de Novarti, que l’apologie d’une firme est la pratique narrative la plus toxique qui existe, qu’il s’agisse de Google, de Fiat, de Facebook, de Disney ou de Nestlé… tant qu’on ne se rendra pas compte de cela, nous resterons pris dans la Toile comme dans un filet.
Il y a des multinationales qui, tous les jours (en ligne) exproprient des richesses sociales et (dans les coulisses) pressurent la main-d’œuvre aux quatre coins du monde, et pourtant, elles sont considérées comme… « moins multinationales » que les autres. Tant qu’on ne se rendra pas compte qu’Apple est comme Monsanto, que Google est à l’image de Novarti, que l’apologie d’une firme est la pratique narrative la plus toxique qui existe, qu’il s’agisse de Google, de Fiat, de Facebook, de Disney ou de Nestlé… tant qu’on ne se rendra pas compte de cela, nous resterons pris dans la Toile comme dans un filet.
[ N.B. : Pour éviter tout malentendu : je possède un Mac et je travaille bien avec. J’ai aussi un iPod, un Smartphone avec Android et Kindle. Ceux qui connaissent mon travail y ont vu à l’œuvre les modalités d’utilisation de la culture et de la Toile que je privilégie. Comme je l’expliquerai mieux ci-dessous, ma critique ne se concentre pas sur l’accusation d’ « incohérence » de l’individu et sur le comportement individuel du consommateur, sur lequel on a construit ces dernières années une rhétorique confusionniste, mais sur la nécessité de relier l’activisme en ligne avec les luttes qui surviennent « en amont », dans la production matérielle.]
Par la faute du net-fétichisme, on met chaque jour l’accent sur les pratiques libératrices qui agitent la Toile – pratiques sur lesquelles, pour être clairs, nous autres Wu Ming parions chaque jour depuis vingt ans – en les décrivant comme la règle et on classe comme exceptions, implicitement, les pratiques assujettissantes : le Réseau utilisé pour sous-payer le travail intellectuel ; pour contrôler et emprisonner les personnes (voir ce qui s’est passé après les émeutes londoniennes) ; pour imposer de nouvelles idoles et fétiches alimentant de nouveaux conformismes ; pour véhiculer l’idéologie dominante ; pour les échanges du capitalisme financier en train de nous détruire. En ligne, les pratiques assujettissantes sont la règle autant que les autres. Et même, si on veut vraiment être précis, il faudrait les considérer comme la règle plus que les autres, si nous tenons compte de la généalogie d’Internet, qui a évolué à partir d’ARPAnet, réseau informatique militaire.
La question n’est pas de savoir si la Toile procure libération ou assujettissement : elle produit toujours, et depuis le début, les deux. C’est sa dialectique, un aspect est toujours là avec l’autre. Parce que la Toile est la forme que prend aujourd’hui le capitalisme, et le capitalisme est à chaque instant contradiction en procès. Le capitalisme s’affirma en libérant les subjectivités (des liens féodaux, des anciennes servitudes) et en imposant en même temps de nouveaux assujettissements (au temps discipliné de l’usine, à la production de plus-value). Dans le capitalisme, tout fonctionne ainsi : la consommation émancipe et esclavagise, engendre une libération qui est un nouvel assujettissement, et le cycle repart à un niveau plus élevé.
La question n’est pas de savoir si la Toile procure libération ou assujettissement : elle produit toujours, et depuis le début, les deux. C’est sa dialectique, un aspect est toujours là avec l’autre. Parce que la Toile est la forme que prend aujourd’hui le capitalisme, et le capitalisme est à chaque instant contradiction en procès. Le capitalisme s’affirma en libérant les subjectivités (des liens féodaux, des anciennes servitudes) et en imposant en même temps de nouveaux assujettissements (au temps discipliné de l’usine, à la production de plus-value). Dans le capitalisme, tout fonctionne ainsi : la consommation émancipe et esclavagise, engendre une libération qui est un nouvel assujettissement, et le cycle repart à un niveau plus élevé.
L’ éolipyle d’Héron
La lutte alors devrait se résumer ainsi : prendre appui sur la libération pour combattre l’assujettissement. Multiplier les pratiques libératrices et les utiliser contres les pratiques assujettissantes. Mais cela n’est possible qu’en cessant de penser à la technologie comme une force autonome et en reconnaissant qu’elle est modelée par les rapports de propriété et de production, et orientée par les relations de pouvoir et de classe. Si la technologie s’imposait en dehors de tels rapports, simplement parce qu’elle est innovatrice, la machine à vapeur serait entrée en usage dès le 1er siècle après J. C., quand Héron d’Alexandrie inventa l’éolipyle. Mais le mode de production antique n’avait pas besoin de machines, parce que toute la force de travail nécessaire était fournie par les esclaves, et personne ne put ou ne voulut imaginer une application concrète.
C’est le fétichisme de la technologie comme force autonome qui nous fait toujours retomber dans la vieille grille « apocalyptiques contre intégrés ». À la moindre esquisse de critique sur la Toile, on te traite d’ « apocalyptique » et on t’accuse d’incohérence et/ou d’obscurantisme. La première accusation, en général, prend la forme de phrases comme : « Tu n’es pas en train d’utiliser un ordinateur en ce moment même ? » ; « Tu ne les achètes pas toi aussi sur Amazon, tes livres ? » ; « Tu n’aimes pas, toi aussi, les Smartphones ? » etc. La deuxième repose sur d’inutiles petites leçons du genre : « Pense un peu si aujourd’hui, il n’y avait pas Internet… » De l’autre côté, tout discours sur les usages positifs d’Internet est accueilli par les « apocalyptiques » comme la servile propagande d’un « intégré ». Rappelons-nous toujours Héron d’Alexandrie. Son histoire nous enseigne que quand nous parlons de technologie, et plus précisément d’Internet, en réalité, nous parlons d’autre chose, c’est-à-dire de rapports sociaux.
En somme, revenons à la question : qui sont les maîtres d’Internet ? Et qui sont les exploités de la Toile et par la Toile ? Le découvrir n’est en fait pas si difficile : il suffit de lire les « normes d’utilisation » des réseaux sociaux auxquels nous sommes inscrits ; de se pencher sur les licences des logiciels que nous utilisons ; de taper sur un moteur de recherche l’expression « Net neutrality »… Et, cerise sur le gâteau, de garder à l’esprit des histoires comme celles des entrepôts Amazon et Foxconn. Ce n’est que de cette manière, je crois, que nous éviterons des bêtises comme la campagne « Internet for Peace » ou, pire, des récits prophétiques horribles pointant le « totalitarisme doux », comme celui émergeant de la célèbre vidéo de Casaleggio & Associati intitulée Gaia : The Future of Politics [7].
Ne nous faisons pas d’illusions : ce seront des conflits très durs qui établiront si l’évolution d’Internet correspondra à un primat de la pratique de libération sur celle d’assujettissement ou le contraire.
Le travail (de merde) incorporé dans la tablette
Ceux qui considèrent que la théorie marxienne de la valeur-travail ne tient plus dans le capitalisme d’aujourd’hui prennent souvent l’exemple de l’iPad pour valider leur position. Selon eux, le travail physique accompli par l’ouvrier pour assembler la tablette est peu de chose, la valeur de la tablette étant apportée par le logiciel et par les applications qui tournent autour, donc par le travail mental, cognitif, de conception et de programmation. Travail qui « s’échappe » de toutes parts, inquantifiable en termes d’heures de travail. Ceci mettrait en déroute l’idée marxienne selon laquelle – je simplifie violemment – la valeur d’une marchandise est donnée par la quantité de travail qu’elle incorpore, ou mieux : par le temps de travail socialement nécessaire pour la produire. Par « temps de travail socialement nécessaire », Marx entend le temps moyen utilisé par les producteurs d’une marchandise donnée à une phase donnée du développement capitaliste.
Je ne suis pas un expert en économie politique, mais il me semble que ce sont deux niveaux qui coexistent. Peut-être la théorie de la valeur-travail est-elle trop vite abandonnée ? Je crois que son noyau de sens (noyau « philosophique » et très concret) perdure même avec le changement des conditions.
Aujourd’hui, le travail est beaucoup plus socialisé qu’au temps de Marx, et les processus productifs bien plus complexes (et le capital bien plus conditionné par les limites externes, c’est-à-dire environnementales). Pourtant, ceux qui avancent cet exemple raccourcissent le cycle et isolent l’acte de l’assemblage dans un seul iPad. Il faudrait prendre en considération la masse de travail le long de la totalité du cycle productif d’une fournée entière de tablettes (ou de laptop, de Smartphone, de e-reader, ce que vous voulez). Comme disait justement Tuco dans la discussion où a commencé à prendre forme la présente réflexion :
« Un des points essentiel est que toute la baraque ne pourrait jamais se mettre en mouvement pour produire cent iPad. Il faut en produire au moins cent millions. À première vue, il pourrait sembler que le travail intellectuel nécessaire pour développer le logiciel de l’iPad engendre par lui-même de la valeur, indépendamment du reste du cycle productif. Mais cela voudrait dire que la valeur engendrée par ce travail intellectuel est indépendante du nombre d’iPad qui sont produits. En réalité, il n’en est pas ainsi. S’il ne faisait pas partie d’un cycle qui prévoit la production dans des modalités fordistes de cent millions d’iPad, ce travail intellectuel n’engendrerait pratiquement aucune valeur. »
Aujourd’hui, le travail est beaucoup plus socialisé qu’au temps de Marx, et les processus productifs bien plus complexes (et le capital bien plus conditionné par les limites externes, c’est-à-dire environnementales). Pourtant, ceux qui avancent cet exemple raccourcissent le cycle et isolent l’acte de l’assemblage dans un seul iPad. Il faudrait prendre en considération la masse de travail le long de la totalité du cycle productif d’une fournée entière de tablettes (ou de laptop, de Smartphone, de e-reader, ce que vous voulez). Comme disait justement Tuco dans la discussion où a commencé à prendre forme la présente réflexion :
« Un des points essentiel est que toute la baraque ne pourrait jamais se mettre en mouvement pour produire cent iPad. Il faut en produire au moins cent millions. À première vue, il pourrait sembler que le travail intellectuel nécessaire pour développer le logiciel de l’iPad engendre par lui-même de la valeur, indépendamment du reste du cycle productif. Mais cela voudrait dire que la valeur engendrée par ce travail intellectuel est indépendante du nombre d’iPad qui sont produits. En réalité, il n’en est pas ainsi. S’il ne faisait pas partie d’un cycle qui prévoit la production dans des modalités fordistes de cent millions d’iPad, ce travail intellectuel n’engendrerait pratiquement aucune valeur. »

Ce point établi, pour considérer combien de travail va s’incorporer dans une tablette, on peut : 1) Partir de la découverte d’une matière première comme le lithium. Sans lui, il n’existerait pas de batteries rechargeables pour nos gadgets. Dans la nature, il n’existe pas de forme « pure » et le processus pour l’obtenir est coûteux et a un impact sur l’environnement (70 % des gisements mondiaux sont situés au fond des lacs salés de Bolivie, et le gouvernement bolivien n’a aucune intention de les brader. Outre ces problèmes géopolitiques, les tremblements de terre viennent encore compliquer la situation [8]) ; 2) Prendre en considération les nuisances subies par les travailleurs de l’industrie pétrochimique qui produit les polymères nécessaires ; 3) Considérer le travail sans garanties des ouvriers qui assemblent les dispositifs (sur la manière dont on travaille à Foxconn, on en a déjà parlé ci-dessus) ; 4) Arriver au travail (indigne, nocif, aux limites de l’inhumain) de ceux qui traitent la carcasse du laptop ou de la tablette dans quelque décharge africaine. S’agissant d’une marchandise à obsolescence rapide et surtout programmée, ce travail est déjà incorporé en elle, dès la phase de la conception.
En prenant tout cela en considération, on verra qu’en fait de travail physique (travail de merde, exploité, sous-payé, nocif, etc.), une fournée d’iPad en incorpore beaucoup, et avec lui une grande quantité de temps de travail. Et il ne fait pas de doute qu’il s’agit de temps de travail socialement nécessaire : aujourd’hui les iPad se produisent ainsi et pas autrement. Sans ce travail, le general intellect appliqué qui invente et ajourne le logiciel n’existerait simplement pas. Donc, il ne produirait aucune valeur. Si « pour faire une planche, il faut du bois » ; pour faire la tablette, il faut un ouvrier (et avant encore, un mineur, etc.). Sans les ouvriers et leur travail, pas de valorisation de la marchandise digitale, pas de cotation d’Apple en bourse, etc. Actionnaires et investisseurs accordent du crédit à la pomme parce qu’elle produit, valorise et vend du matériel informatique et des gadgets, et, de temps en temps, fait un nouveau « coup », en mettant sur le marché un nouveau « petit bijou ». Et qui le fait, ce petit bijou ? Je ne suis pas en mesure de dire si une comptabilité précise en terme d’heures de travail est envisageable (je le répète : je ne suis pas un expert en économie politique). Mais je sais que quand nous jetons aux ordures un mobile qui fonctionne parfaitement parce que le nouveau modèle « fait plus de choses », nous jetons une portion de vie et de labeur d’une grande masse de travailleurs, souvent payés avec trois sous et – dans la meilleure des hypothèses – un coup de pied au cul.
Intelligence collective, travail invisible et média social
Ce que je suis en train de dire, Marx l’anticipait déjà dans le Chapitre VI inédit du Capital :
« En se développant, les forces de production de la société, ou forces productives du travail, se socialisent et deviennent directement sociales (collectives), grâce à la coopération, la division du travail au sein de l’atelier, l’emploi du machinisme et, en général, les transformations que subit le process de production grâce à l’emploi conscient des sciences naturelles, de la mécanique, de la chimie, etc. appliquées à des fins technologiques déterminées, et grâce à tout ce qui se rattache au travail effectué à une grande échelle, etc. […]
Tout ce développement de la force productive du travail socialisé, de même que l’application au process de production immédiat de la science, ce produit général du développement social, s’opposent au travail plus ou moins isolé et dispersé de l’individu particulier, et ce d’autant que le tout se présente directement comme force productive du capital, et non comme force productive du travail, que ce soit celle du travailleur isolé, des travailleurs associés dans le process de production, ou même d’une force productive du travail qui s’identifierait au capital. »
« En se développant, les forces de production de la société, ou forces productives du travail, se socialisent et deviennent directement sociales (collectives), grâce à la coopération, la division du travail au sein de l’atelier, l’emploi du machinisme et, en général, les transformations que subit le process de production grâce à l’emploi conscient des sciences naturelles, de la mécanique, de la chimie, etc. appliquées à des fins technologiques déterminées, et grâce à tout ce qui se rattache au travail effectué à une grande échelle, etc. […]
Tout ce développement de la force productive du travail socialisé, de même que l’application au process de production immédiat de la science, ce produit général du développement social, s’opposent au travail plus ou moins isolé et dispersé de l’individu particulier, et ce d’autant que le tout se présente directement comme force productive du capital, et non comme force productive du travail, que ce soit celle du travailleur isolé, des travailleurs associés dans le process de production, ou même d’une force productive du travail qui s’identifierait au capital. »
En substance, Marx dit que :
1) La nature collective et coopérative du travail vient à être réellement soumise (on traduit parfois par « subsumée ») au capital, c’est-à-dire que c’est une nature collective spécifique qui, avant le capital, n’existait pas. La « soumission réelle » du travail au capital est opposée par Marx à la « soumission formelle », typique des débuts du capitalisme, quand le capital soumettait des typologies de travail pré-existantes : le tissage manuel, les processus du travail agricole, etc. « Soumission (ou subsussion) réelle » signifie que le capital rend force productive une coopération sociale qui ne pré-existait pas à lui, parce que ne pré-existait à lui ni ouvriers, ni travail salarié, ni machines, ni nouveaux réseaux de transport et de distribution.
2) Plus le processus productif est avancé (grâce à l’application de la science et de la technologie), plus sera mystifiée la représentation (aujourd’hui, on dirait la narration) de la coopération productive.
1) La nature collective et coopérative du travail vient à être réellement soumise (on traduit parfois par « subsumée ») au capital, c’est-à-dire que c’est une nature collective spécifique qui, avant le capital, n’existait pas. La « soumission réelle » du travail au capital est opposée par Marx à la « soumission formelle », typique des débuts du capitalisme, quand le capital soumettait des typologies de travail pré-existantes : le tissage manuel, les processus du travail agricole, etc. « Soumission (ou subsussion) réelle » signifie que le capital rend force productive une coopération sociale qui ne pré-existait pas à lui, parce que ne pré-existait à lui ni ouvriers, ni travail salarié, ni machines, ni nouveaux réseaux de transport et de distribution.
2) Plus le processus productif est avancé (grâce à l’application de la science et de la technologie), plus sera mystifiée la représentation (aujourd’hui, on dirait la narration) de la coopération productive.
Maintenant, cherchons à notre époque les exemples de cette formulation : la production de sens et de relations sur Internet n’est pas considérée comme force productive des travailleurs coopérants ; l’idéologie dominante permet encore moins de reconnaître le travail de l’individu singulier. Cette production est attribuée (de manière trompeuse, mythologique) directement au capital, à l’ « esprit d’entreprise » du présumé génie du capitaliste, etc. Par exemple, on dit que c’est grâce à une « intuition » de Mark Zuckerberg si aujourd’hui Facebook, bla bla bla. Tout aussi souvent, une telle production de sens est considérée, comme dit Marx, au sens de « force productive du travail qui s’identifierait au capital ». Traduisons : l’exploitation est occultée derrière la façade d’un travail en réseau autonome, non subordonné, fait tout entier d’auto-entreprise et/ou de libre contrat, et/ou en tout cas beaucoup plus « cool » que les travaux « traditionnels », quand en fait la production de contenus en réseau progresse aussi grâce au travail très subordonné de masses de « nègres » - dans le sens d’auteurs-fantômes.
Existe-t-il, pour utiliser une expression marxienne, une Gemeinwesen, une tendance de l’être humain au commun, à la communauté, à la coopération ? Oui, elle existe. Il est toujours risqué d’utiliser cette expression, mais s’il y a un universel anthropologique, eh bien, c’est cet « animal convivial », compagnevole animale : ainsi Dante traduit-il le zòon politikon d’Aristote (comme le rappelle Girolamo De Michele dans son dernier livre, Filosofia) et les neurosciences sont en train de démontrer que nous sommes… « câblés » pour la Gemeinwesen (découverte des neurones-miroirs, etc.). Aucun mode de production n’a, comme le capitalisme, à ce niveau de puissance, subsumé et rendu productive la tendance humaine à la coopération. Aujourd’hui, l’exemple le plus éclatant de coopération subsumée – et en même temps de travail invisible, non perçu comme tel –, ce sont les réseaux sociaux qui nous les fournissent.
Prenons l’exemple de Facebook. Pas parce que les autres réseaux sont « moins sauvages », mais parce que pour le moment, c’est le plus gros, celui qui fait le plus d’argent et qui est – comme le démontre la très récente vague de nouvelles options et applications – le plus enveloppant, invasif et expansionniste. Facebook avance comme s’il voulait englober tout le net, se substituer à lui. C’est le réseau social par excellence, donc, il nous fournit l’exemple le plus clair.
Tu es l’un des sept cents millions d’usagers de Facebook ? Bien, cela veut dire que presque chaque jour, tu produis des contenus pour le réseau : contenus de tout genre, en particulier des contenus affectifs et relationnels. Tu fais partie du general intellect de Facebook. En somme, Facebook existe et fonctionne grâce à des gens comme toi. De quoi Facebook est-il le nom, sinon de cette intelligence collective qui n’est pas le produit de Zuckerberg et compagnie, mais des usagers ?
Sur Facebook, tu fais du travail. Tu ne t’en rends pas compte, mais tu travailles. Tu travailles sans être payé. Ce sont d’autres qui se font de l’argent avec ton travail.
Ici, le concept marxien qui s’avère utile est celui de « surtravail ». Ce n’est pas un concept abscons : il signifie « la partie du travail qui, tout en produisant de la valeur, ne se traduit pas en salaire mais en profit pour le patron, en tant que propriétaire des moyens de production ». Quand il y a du profit, cela veut dire qu’il y a du surtravail. Autrement, si toute la quantité de travail était rémunérée sur la base de la valeur qu’elle a créée, eh bien… ce serait le communisme, la société sans classes. Il est clair que le patron doit payer en salaires moins que ce qu’il va tirer de la vente des marchandises. « Profit » signifie cela. Ça signifie payer aux travailleurs moins que la valeur réelle du travail qu’ils accomplissent. Pour différents motifs, le patron peut ne pas réussir à les vendre, ces marchandises. Et donc ne pas réaliser de profits. Mais cela ne signifie pas que les travailleurs n’ont pas effectué de surtravail. La société capitaliste toute entière est basée sur la valeur et le surtravail.
Sur Facebook, ton travail est tout entier surtravail, parce qu’il n’est pas payé. Zuckerberg chaque jour vend ton surtravail, c’est à dire qu’il vend ta vie (les données sensibles, les caractéristiques de ta navigation, etc.) et tes relations, et gagne quotidiennement pas mal de millions de dollars grâce à elles. Parce que lui est propriétaire du moyen de production, toi non. L’information est marchandise. La connaissance est marchandise. Et même, dans le postfordisme, ou quel que soit le nom que nous voulons donner au présent stade du capitalisme, c’est la marchandise des marchandises. L’information est force productive et marchandise à la fois, exactement comme la force de travail. La communauté qui utilise Facebook produit de l’information (sur les goûts, sur les modèles de consommation, sur les tendances du marché) que le patron empaquette sous forme de statistiques et vend à des tiers et/ou utilise pour personnaliser la publicité, les offres et transactions de divers genre. En outre, le même Facebook, comme représentation du réseau de relations le plus étendu de la planète, est une marchandise. L’entreprise Facebook peut vendre des informations seulement si, en même temps et sans relâche, elle vend cette représentation d’elle-même. Une telle représentation aussi est due aux usagers, mais celui qui remplit son compte en banque, c’est Zuckerberg.
Tu es l’un des sept cents millions d’usagers de Facebook ? Bien, cela veut dire que presque chaque jour, tu produis des contenus pour le réseau : contenus de tout genre, en particulier des contenus affectifs et relationnels. Tu fais partie du general intellect de Facebook. En somme, Facebook existe et fonctionne grâce à des gens comme toi. De quoi Facebook est-il le nom, sinon de cette intelligence collective qui n’est pas le produit de Zuckerberg et compagnie, mais des usagers ?
Sur Facebook, tu fais du travail. Tu ne t’en rends pas compte, mais tu travailles. Tu travailles sans être payé. Ce sont d’autres qui se font de l’argent avec ton travail.
Ici, le concept marxien qui s’avère utile est celui de « surtravail ». Ce n’est pas un concept abscons : il signifie « la partie du travail qui, tout en produisant de la valeur, ne se traduit pas en salaire mais en profit pour le patron, en tant que propriétaire des moyens de production ». Quand il y a du profit, cela veut dire qu’il y a du surtravail. Autrement, si toute la quantité de travail était rémunérée sur la base de la valeur qu’elle a créée, eh bien… ce serait le communisme, la société sans classes. Il est clair que le patron doit payer en salaires moins que ce qu’il va tirer de la vente des marchandises. « Profit » signifie cela. Ça signifie payer aux travailleurs moins que la valeur réelle du travail qu’ils accomplissent. Pour différents motifs, le patron peut ne pas réussir à les vendre, ces marchandises. Et donc ne pas réaliser de profits. Mais cela ne signifie pas que les travailleurs n’ont pas effectué de surtravail. La société capitaliste toute entière est basée sur la valeur et le surtravail.
Sur Facebook, ton travail est tout entier surtravail, parce qu’il n’est pas payé. Zuckerberg chaque jour vend ton surtravail, c’est à dire qu’il vend ta vie (les données sensibles, les caractéristiques de ta navigation, etc.) et tes relations, et gagne quotidiennement pas mal de millions de dollars grâce à elles. Parce que lui est propriétaire du moyen de production, toi non. L’information est marchandise. La connaissance est marchandise. Et même, dans le postfordisme, ou quel que soit le nom que nous voulons donner au présent stade du capitalisme, c’est la marchandise des marchandises. L’information est force productive et marchandise à la fois, exactement comme la force de travail. La communauté qui utilise Facebook produit de l’information (sur les goûts, sur les modèles de consommation, sur les tendances du marché) que le patron empaquette sous forme de statistiques et vend à des tiers et/ou utilise pour personnaliser la publicité, les offres et transactions de divers genre. En outre, le même Facebook, comme représentation du réseau de relations le plus étendu de la planète, est une marchandise. L’entreprise Facebook peut vendre des informations seulement si, en même temps et sans relâche, elle vend cette représentation d’elle-même. Une telle représentation aussi est due aux usagers, mais celui qui remplit son compte en banque, c’est Zuckerberg.
Évidemment, le genre de « travail » décrit ici n’est pas comparable, en terme de pénibilité et d’exploitation, au travail décrit dans les premiers paragraphes de ce texte. En outre, les usagers de Facebook ne constituent pas une « classe ». L’essentiel est que nous devons, à chaque moment, tenir en considération aussi bien les efforts pénibles à la base de la production de matériel informatique, que la privatisation prédatrice de l’intelligence collective qui a lieu en lien. Comme je l’écrivais ci-dessus : « Les deux niveaux coexistent ». La valorisation dépend des deux activités, elles doivent être visualisées et analysées ensemble.
Il n’y a pas de dedans ni de dehors
Si après ce discours, on me demandait : « Alors, la solution, c’est d’être en dehors des réseaux sociaux ? » ; Ou bien : « la solution est d’utiliser seulement un logiciel libre ? » ; Ou encore : « la solution est de ne pas acheter de machine ? » ; je répondrais que la question est mal posée. Certainement, construire à la base des réseaux sociaux différents, fonctionnant avec des logiciels libres et non basés sur le commerce des données sensibles et de relations, est une belle et bonne chose. Mais ça l’est aussi de maintenir une présence critique et informative dans lieux où vit et communique la majorité des personnes, peut-être en expérimentant des modes conflictuels d’utilisation des réseaux existants.
Voilà trop longtemps que dure l’hégémonie d’un dispositif qui « individualise » la révolte et la lutte, en mettant l’accent avant tout sur ce que peut faire le consommateur (ce sujet continuellement reproduit par des technologies sociales précises) : boycott, critiques, choix personnels plus radicaux, etc. Les choix personnels sont importants mais : 1) Trop souvent, cette manière de raisonner déclenche un concours à qui sera plus « cohérent » et le plus « pur », et il y aura toujours quelqu’un qui brandira des choix plus radicaux que les miens : le vegan attaque le végétarien, le frugivore attaque le crudiste qui attaque le vegan, etc. Chacun revendique d’être plus « dehors », plus « extérieur » à la valorisation, images tout à fait illusoires. 2) Le consommateur est le dernier anneau de la chaîne distributive, ses choix adviennent à l’embouchure, pas à la source. Et peut-être faudrait-il conseiller plus souvent la lecture d’un texte « mineur » de Marx, la Critique du progamme de Gotha, où est critiqué le « socialisme vulgaire », qui part de la critique de la distribution plutôt que de la production.
Voilà trop longtemps que dure l’hégémonie d’un dispositif qui « individualise » la révolte et la lutte, en mettant l’accent avant tout sur ce que peut faire le consommateur (ce sujet continuellement reproduit par des technologies sociales précises) : boycott, critiques, choix personnels plus radicaux, etc. Les choix personnels sont importants mais : 1) Trop souvent, cette manière de raisonner déclenche un concours à qui sera plus « cohérent » et le plus « pur », et il y aura toujours quelqu’un qui brandira des choix plus radicaux que les miens : le vegan attaque le végétarien, le frugivore attaque le crudiste qui attaque le vegan, etc. Chacun revendique d’être plus « dehors », plus « extérieur » à la valorisation, images tout à fait illusoires. 2) Le consommateur est le dernier anneau de la chaîne distributive, ses choix adviennent à l’embouchure, pas à la source. Et peut-être faudrait-il conseiller plus souvent la lecture d’un texte « mineur » de Marx, la Critique du progamme de Gotha, où est critiqué le « socialisme vulgaire », qui part de la critique de la distribution plutôt que de la production.
Je suis en train d’essayer d’expliquer depuis un certain temps que selon moi, les métaphores spatiales (comme le « dehors » et le « dedans ») sont inadéquates, parce qu’il est clair que si la question est « où est le dehors ? » la réponse – ou l’absence de réponse – ne peut être que paralysante. Parce que la question l’est déjà.
Peut-être est-il plus utile de raisonner et de s’exprimer en termes temporels. Il s’agit de comprendre combien de temps de vie (combien de temps et combien de vies) le capital est en train de voler, et surtout comment il le fait en cachette (parce qu’un tel vol est présenté comme une « chose naturelle »), de devenir conscients des différentes formes d’exploitation, et donc de lutter dans le rapport de production, dans les relations de pouvoir, en contestant les arrangements propriétaires et la « naturalisation » de l’expropriation, pour ralentir les rythmes, interrompre l’exploitation, reconquérir des bouts de vie.
Ce n’est certes pas nouveau : autrefois, on appelait ça « lutte de classes ». En bref : les intérêts des travailleurs et ceux du patron sont différents et irréconciliables. Toute idéologie qui masque cette différence (idéologie entrepreneuriale, nationaliste, raciale, etc.) est à combattre. Pensons aux débuts du mouvement ouvrier. Un prolétaire travaille douze-quatorze heures par jour, dans des conditions effroyables, et son sort est même partagé par des enfants qui ne voient jamais la lumière du soleil. Qu’est-ce qu’il fait ? Il lutte. Il lutte jusqu’à ce qu’il arrache la journée de huit heures, le paiement des heures supplémentaires, les normes sanitaires, le droit d’organisation et de grève, la législation contre le travail des mineurs… Et il se réapproprie une partie de son temps, et affirme sa dignité, jusqu’à ce que ce que ces conquêtes soient remises en causes et qu’il lui faille lutter de nouveau.
Déjà, se rendre compte que notre rapport avec les choses n’est ni neutre ni innocent, y débusquer l’idéologie, découvrir le fétichisme de la marchandise, est une conquête : nous serons peut-être cocus de toute façon, mais au moins pas cocus et contents. Le mal demeure, mais pas l’escroquerie de se sentir libres dans un cadre où nous sommes exploités. Trouver toujours les dispositifs qui nous assujettissent, et les décrire en essayant de concevoir le moyen de les mettre en crise.
Ce n’est certes pas nouveau : autrefois, on appelait ça « lutte de classes ». En bref : les intérêts des travailleurs et ceux du patron sont différents et irréconciliables. Toute idéologie qui masque cette différence (idéologie entrepreneuriale, nationaliste, raciale, etc.) est à combattre. Pensons aux débuts du mouvement ouvrier. Un prolétaire travaille douze-quatorze heures par jour, dans des conditions effroyables, et son sort est même partagé par des enfants qui ne voient jamais la lumière du soleil. Qu’est-ce qu’il fait ? Il lutte. Il lutte jusqu’à ce qu’il arrache la journée de huit heures, le paiement des heures supplémentaires, les normes sanitaires, le droit d’organisation et de grève, la législation contre le travail des mineurs… Et il se réapproprie une partie de son temps, et affirme sa dignité, jusqu’à ce que ce que ces conquêtes soient remises en causes et qu’il lui faille lutter de nouveau.
Déjà, se rendre compte que notre rapport avec les choses n’est ni neutre ni innocent, y débusquer l’idéologie, découvrir le fétichisme de la marchandise, est une conquête : nous serons peut-être cocus de toute façon, mais au moins pas cocus et contents. Le mal demeure, mais pas l’escroquerie de se sentir libres dans un cadre où nous sommes exploités. Trouver toujours les dispositifs qui nous assujettissent, et les décrire en essayant de concevoir le moyen de les mettre en crise.
La marchandise digitale que nous utilisons incorpore de l’exploitation, devenons-en conscients. La Toile se dresse sur de gigantesques colonnes de travail invisible, rendons-les visibles. Et rendons visibles les luttes, les grèves. En Occident, on en parle peu, mais en Chine des grèves éclatent et éclateront de plus en plus. Quand un paumé devient un tycoon, allons voir sur quelles têtes il a marché pour arriver où il est, quel travail il a exploité, quel surtravail il n’a pas rémunéré. Quand je parle de « défitichiser le net », j’entends l’acquisition de cette conscience. Qui est la précondition pour être « dedans et contre », dedans de manière conflictuelle.
Et si nous sommes « dans et contre » le net, peut-être pourrons-nous trouver le moyen de nous allier avec ceux qui sont exploités en amont. Une alliance mondiale entre « activistes digitaux », travailleurs cognitifs et ouvriers de l’industrie électronique serait, pour les patrons de la Toile, la plus épouvantable des nouvelles. Les formes de cette alliances, bien sûr, sont entièrement à découvrir.

Notes
[1] L’article est du 26/09/11.
[2] L’expression « longue traîne » (de l’anglais Long Tail, parfois traduite par « longue queue ») a été employée pour la première fois en 2004 par Chris Anderson dans un article de Wired pour décrire une partie du marché des entreprises telles qu’Amazon ou Netflix, qui vendent de nombreux produits, chacun en petite quantité. (Wikipédia).
[3] NdT : Patron actuel de la Fiat qui, à coups de chantage à l’emploi et de promesses impossibles à tenir, impose une régression du droit syndical dans les derniers établissements de l’entreprise en Italie (voir mon article de mars 2011 dans Le Monde Diplomatique.
[4] Trois jours après la publication de cet article en Italie, Amazon a présenté au monde sa tablette, Kindle Fire, conçue et construite pour faire concurrence à l’iPad. Il est parfaitement logique que Kindle Fire aussi soit fabriqué dans les établissements Foxconn. Les ouvriers mourront de l’envie (des autres) de la posséder.
[5] Pour approfondir ce thème, je conseille les liens rassemblés dans la page Wikipédia et la vision de la vidéo révélatrice Deconstructing Foxconn
[6]
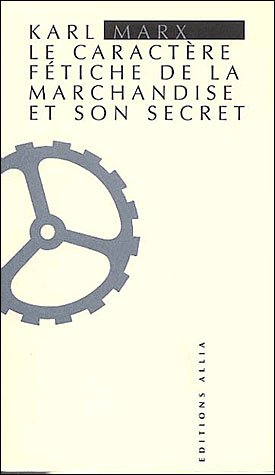
[7] Casaleggio & Associati est l’agence de marketing dont est propriétaire Andrea Casaleggio, idéologue du mouvement populiste et poujadiste fondé par l’ex-comique Beppe Grillo.
[8] 70 % de la production actuelle d’un polymère indispensable aux batteries au lithium vient du Japon, et l’un des établissements qui le réalise a dû être fermé à la suite du tremblement de terre.




















Sem comentários:
Enviar um comentário